Bonjour Romuald Giulivo, la première question est un petit rituel de présentation ... Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? 
Architecte naval de formation, j’ai constaté après plusieurs années de servage que mon horizon quotidien n’était pas peuplé par les mâts de bateaux et les haubans claquant au vent, mais plutôt par les tours vitrées des quartiers d’affaires. La première occasion de mettre les voiles pour un ailleurs a été la littérature, et je me suis aussitôt embarqué.
Depuis, je ne vois pas forcément la mer plus souvent, mais je profite de l’écriture pour vivre toutes les vies que la réalité nous refuse.
L’écriture a-t-elle été toujours présente dans votre vie ? Quel a été le déclic pour vous lancer dans l’aventure du roman ? 
Je n’ai pas noirci des cahiers étant enfant, je n’ai pas composé des pages de poésie fébriles à l’adolescence. Je n’ai même pas le souvenir d’avoir terminé un livre avant le lycée. Adolescent, je me suis surtout ennuyé. C’est ainsi que je suis tombé dans la lecture. Par dépit et par ennui. Et puis probablement parce que la littérature demeure, pour qui sait la manier, un outil assez efficace afin d’approcher les filles... C’est en tout cas ce que j’ai imaginé l’été de mes seize ans, en dévorant Zone érogène de Philippe Djian, puis tous ses autres romans parus à l’époque.
Quant à l’écriture, c’est arrivé bien plus tard, et également par hasard. J’avais rencontré Jean-Luc Bizien – dans des circonstances que la bienséance et une longue amitié m’interdisent aujourd’hui de préciser – et nous passions beaucoup de soirées à discuter littérature, refaire le monde ou manger du poulet aux cinq parfums. Jean-Luc était en train d’écrire son premier roman, quand je l’ai accompagné un soir dans un salon du livre. Nous y avons bu quelques verres, nous y avons discuté avec beaucoup de gens. Je ne me souviens plus de grand-chose. Si ce n’est que j’avais le lendemain une sérieuse migraine, et aussi un contrat pour écrire un bouquin.
Il a donc fallu s’y mettre, sans attendre et sans réfléchir. Inutile de préciser que je n’y serais jamais parvenu sans le soutien indéfectible de Jean-Luc...
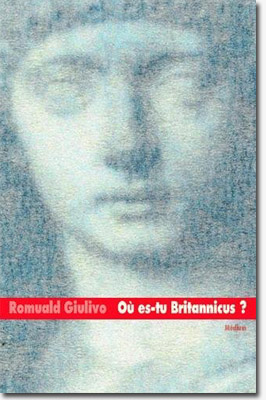 Votre roman Où es-tu Britannicus ? est sorti en avril, pourriez-vous nous le présenter ?
Votre roman Où es-tu Britannicus ? est sorti en avril, pourriez-vous nous le présenter ? 
C’est une relecture des derniers jours de Britannicus, la réécriture d’une histoire classique, mais qui cette fois doit plus aux premiers romans de Bret Easton Ellis qu’à la pièce de Racine.
Comment vous est venue l'idée de (re) donner vie à Britannicus ?
L’idée est venue à rebours. Il m’arrive parfois d’avoir du mal à lire de la fiction – soit parce que je ne trouve pas musique à mon oreille à ce moment-là, soit au contraire parce que mes lectures résonnent trop fort avec la vie. Alors dans ces périodes, je me tourne vers des œuvres de philosophie ou d’histoire ou de sciences.
Là, j’étais revenu de l’un de mes voyages à Rome avec une pile d’ouvrages glanés sur place. Un an plus tard, la pile s’étant transformée en bibliothèque, il semblait acquis dans mon entourage que je préparais un roman sur la Rome antique, et on a commencé à m’interroger sur le sujet. Je me suis retrouvé à devoir démentir cette idée, essentiellement parce que le roman historique me barbait, et au prétexte que j’écrivais avant tout sur la figure de l’adolescence.
J’ai tenu ma position jusqu’à ce que je tombe sur
un vieil entretien radiophonique de Paul Veyne. Il y explique en substance que les errances de Néron ou la mort de Britannicus sont le résultat des excès d’une jeunesse dorée. Que ces personnages, transformés en allégories par l’histoire et le théâtre, étaient en fait des gosses de 14 et 16 ans au moment des faits.
Lorsque j’ai découvert cette pépite, je revenais alors vers la fiction par une énième relecture de Less than zero. La collision de ces deux voix m’a fait réaliser que je tenais peut-être un mélange intéressant.
Comment se déroule votre processus d’écriture ? Avez-vous en tête l’intrigue de vos livres dès le début ou évolue-t-elle au fur et à mesure ? 
Je n’ai pas de recettes, si ce n’est celle d’écrire un mot après l’autre. J’aime à me penser proche d’un maçon construisant un mur, pierre après pierre, rang après rang. Écrivant assez lentement, j’ai depuis plusieurs années abandonné toute velléité à construire un plan en amont, j’ai besoin de conserver le plaisir de la découverte, de la surprise. J’ai seulement besoin d’une idée de départ, qui en général se résume à « quelqu’un, quelque part. » Il est fréquent aussi qu’une musique particulière alimente mes envies de style, mais ce n’est pas systématique. La seule règle immuable vient de mon admiration pour Hemingway, qui s’en tenait à 500 mots par jour raconte-t-on, avant de partir chasser le lion ou l’espadon. Ensuite, seul compte une bonne écoute, une relecture attentive chaque matin de la production de la veille.
Pour ce livre cependant, il est évident que le processus s’est trouvé modifié, puisque les personnages ou les événements m’imposaient certains passages obligés. J’ai notamment été très longtemps préoccupé par la fin inéluctable de Britannicus, par la façon dont je pourrais lui donner un sens qui me serait personnel. Heureusement, si l’on étudie de près les sources, on s’aperçoit qu’on en sait très peu sur ces jeunes gens. Les zones d’ombre sont immenses, ce qui laisse une vraie liberté pour les réinventer sans rien trahir de ce qui nous a été transmis.
Vos dialogues sont particulièrement soignés et résolument modernes pour l’époque à laquelle se déroule le roman. Comment les travaillez-vous ? 
Je vous remercie de cette remarque, car les dialogues m’ont effectivement beaucoup occupé, même s’ils ne sont pas si nombreux. Le cœur du projet était de présenter Britannicus ou Néron comme des adolescents qui pourraient très bien vivre aujourd’hui, je voulais leur donner des préoccupations et des rêves qui nous sont proches et montrer que, à deux mille ans de distance, les choses ne se jouent qu’à des détails. Cette intention de proximité, de modernité, se devait de passer avant tout par la langue – qui est toujours, quelle que soit la génération, un signe d’identité et de ralliement majeur. Leur registre de langage est de plus, en termes de progression dramatique, le lieu d’un enjeu important dans leur relation : c’est en se mettant à parler peu à peu comme son frère que Britannicus se perd et se condamne.
Enfin, quant à savoir comment j’ai travaillé, j’ai surtout repris de nombreuses fois ma copie, sur les conseils avisés de mes éditrices à l’École des loisirs.
A la lecture de votre roman, on se rend compte qu’un grand nombre de recherches/documentation doit être nécessaire à leur écriture, comment avez-vous géré cette partie du roman ? 
Comme évoqué précédemment, toutes les recherches se sont effectuées à mon corps défendant, et avant que l’idée du livre ne prenne forme. Le vrai travail a donc surtout été de se détacher de cette documentation, d’en oublier le plus possible pour ne pas être encombré.
Ce qui m’intéressait, c’était avant tout les personnages. Sans chercher à les réhabiliter, je souhaitais les sortir de la caricature dans laquelle une mauvaise interprétation des historiens antiques les enferme depuis de siècles. J’ai donc essayé de retrouver leur âme et leur humanité, en balayant ce qui relevait du décorum ou de la légende, afin de n’en garder que la part universelle, ce qui fait qu’ils sont comme vous et moi.
Je me suis cependant soumis encore à quelques recherches avant de me lancer, mais plutôt techniques. J’ai ainsi épluché un nombre conséquent de romans historiques, du meilleur au moins bon, afin de dresser du genre une sorte de charte, un ensemble de règles impondérables – dont j’ai ensuite pris systématiquement le contre-pied. S’il fallait passer par de longues descriptions des panoramas, je ne ferai aucun portrait de la Rome éternelle ; si l’on devait redonner des détails typiques d’un quotidien ancien, j’attribuerai à mes personnages des habitudes qui sont les nôtres, etc. J’avais déjà bâti l’un de mes précédents textes (Comme une flamme) sur une contrainte semblable, en inversant à l’époque les schémas archétypaux établis par Joseph Campbell dans Le Héros aux mille et un visages – schémas vendus depuis très cher par des tâcherons de Hollywood, qui les prêchent dans des conférences comme des recettes infaillibles au box-office.
Cet exercice, en plus d’être assez ludique, m’a permis de ne jamais dévier de mon sujet. Je n’avais pas pour objet de rendre une page d’histoire dans sa véracité ou ses détails oubliés – quand bien même je ne me suis autorisé aucune liberté avec les faits avérés. Ce que je souhaitais, c’était seulement écrire au plus près des sentiments et des émotions – qui, eux, n’ont ni âge ni époque.
Êtes-vous vous-même lecteur et quels sont vos livres de chevet et vos derniers coups de cœur ? 
J’avoue être plutôt un relecteur qu’un lecteur. J’aime revenir sur des livres qui m’ont marqué, retourner voir entre leurs pages si l’émotion est intacte – et par la même occasion, observer l’agencement des mots et des phrases, comme un garagiste le ferait devant une belle mécanique. Mais il m’arrive encore de faire de chouettes découvertes au rayon des nouveautés. Récemment, j’en citerai deux.
D’abord La Disparition de Jim Sullivan, un exercice de style où Tanguy Viel se livre à une réflexion sur la nature du roman américain, en même temps qu’il en écrit un sous nos yeux. Je suis assez friand de ce genre de livre-dispositif, et celui-ci est très réussi, en plus d’être formidablement bien écrit.
Ensuite, dans un tout autre genre, Katana de Jean-Luc Bizien. Jean-Luc est un ami, mais je resterai à jamais jaloux de ce talent qu’il a pour l’épique et l’aventure, cette capacité de vous saisir en trois phrases pour ne plus vous lâcher. Un superbe récit de samouraï, à couper le souffle et tranchant comme une lame.
Quels sont vos projets à venir ?
J’ai gardé de mon passage dans le monde maritime un mauvais penchant à la superstition. En plus, même une fois terminés, je ne sais pas toujours de quoi mes livres parlent. Tout ce que je peux donc faire ici, c’est vous donner
la musique qui a créé l’envie du texte auquel je travaille actuellement.
Merci beaucoup Romuald Giulivo, nous vous laissons le mot de la fin.
Si vous le permettez, laissons-le plutôt à Philippe Djian :
« Écoute, te vexe pas mais sincèrement je m’en fous de ton histoire, je m’en fous de savoir si c’est vrai ou pas, c’est juste la manière dont tu la racontes qui m’intéresse. »
Zone érogène
Architecte naval de formation, j’ai constaté après plusieurs années de servage que mon horizon quotidien n’était pas peuplé par les mâts de bateaux et les haubans claquant au vent, mais plutôt par les tours vitrées des quartiers d’affaires. La première occasion de mettre les voiles pour un ailleurs a été la littérature, et je me suis aussitôt embarqué.
Je n’ai pas noirci des cahiers étant enfant, je n’ai pas composé des pages de poésie fébriles à l’adolescence. Je n’ai même pas le souvenir d’avoir terminé un livre avant le lycée. Adolescent, je me suis surtout ennuyé. C’est ainsi que je suis tombé dans la lecture. Par dépit et par ennui. Et puis probablement parce que la littérature demeure, pour qui sait la manier, un outil assez efficace afin d’approcher les filles... C’est en tout cas ce que j’ai imaginé l’été de mes seize ans, en dévorant Zone érogène de Philippe Djian, puis tous ses autres romans parus à l’époque.
Votre roman Où es-tu Britannicus ? est sorti en avril, pourriez-vous nous le présenter ?
C’est une relecture des derniers jours de Britannicus, la réécriture d’une histoire classique, mais qui cette fois doit plus aux premiers romans de Bret Easton Ellis qu’à la pièce de Racine.
L’idée est venue à rebours. Il m’arrive parfois d’avoir du mal à lire de la fiction – soit parce que je ne trouve pas musique à mon oreille à ce moment-là, soit au contraire parce que mes lectures résonnent trop fort avec la vie. Alors dans ces périodes, je me tourne vers des œuvres de philosophie ou d’histoire ou de sciences.
Je n’ai pas de recettes, si ce n’est celle d’écrire un mot après l’autre. J’aime à me penser proche d’un maçon construisant un mur, pierre après pierre, rang après rang. Écrivant assez lentement, j’ai depuis plusieurs années abandonné toute velléité à construire un plan en amont, j’ai besoin de conserver le plaisir de la découverte, de la surprise. J’ai seulement besoin d’une idée de départ, qui en général se résume à « quelqu’un, quelque part. » Il est fréquent aussi qu’une musique particulière alimente mes envies de style, mais ce n’est pas systématique. La seule règle immuable vient de mon admiration pour Hemingway, qui s’en tenait à 500 mots par jour raconte-t-on, avant de partir chasser le lion ou l’espadon. Ensuite, seul compte une bonne écoute, une relecture attentive chaque matin de la production de la veille.
Je vous remercie de cette remarque, car les dialogues m’ont effectivement beaucoup occupé, même s’ils ne sont pas si nombreux. Le cœur du projet était de présenter Britannicus ou Néron comme des adolescents qui pourraient très bien vivre aujourd’hui, je voulais leur donner des préoccupations et des rêves qui nous sont proches et montrer que, à deux mille ans de distance, les choses ne se jouent qu’à des détails. Cette intention de proximité, de modernité, se devait de passer avant tout par la langue – qui est toujours, quelle que soit la génération, un signe d’identité et de ralliement majeur. Leur registre de langage est de plus, en termes de progression dramatique, le lieu d’un enjeu important dans leur relation : c’est en se mettant à parler peu à peu comme son frère que Britannicus se perd et se condamne.
Comme évoqué précédemment, toutes les recherches se sont effectuées à mon corps défendant, et avant que l’idée du livre ne prenne forme. Le vrai travail a donc surtout été de se détacher de cette documentation, d’en oublier le plus possible pour ne pas être encombré.
J’avoue être plutôt un relecteur qu’un lecteur. J’aime revenir sur des livres qui m’ont marqué, retourner voir entre leurs pages si l’émotion est intacte – et par la même occasion, observer l’agencement des mots et des phrases, comme un garagiste le ferait devant une belle mécanique. Mais il m’arrive encore de faire de chouettes découvertes au rayon des nouveautés. Récemment, j’en citerai deux.
J’ai gardé de mon passage dans le monde maritime un mauvais penchant à la superstition. En plus, même une fois terminés, je ne sais pas toujours de quoi mes livres parlent. Tout ce que je peux donc faire ici, c’est vous donner la musique qui a créé l’envie du texte auquel je travaille actuellement.
Si vous le permettez, laissons-le plutôt à Philippe Djian :
Du même auteur : Biographie, chronique, interview


